Chers amis,
Juste avant les fêtes de fin d’année, j’ai emprunté à la bibliothèque un DVD du film Boulevard du rhum, sans évidemment savoir que sa principale interprète, Brigitte Bardot, disparaîtrait moins d’une semaine plus tard.
J’ai regardé ce film avec mes enfants, en matière d’hommage.
Dans ce film de Robert Enrico (cinéaste injustement sous-estimé et oublié, auquel on doit le très beau film Le Vieux Fusil), B.B. interprète… une starlette de cinéma qui fait tourner la tête à beaucoup d’hommes !
Un rôle presque autoparodique donc, assez caractéristique de la période « tardive » de Brigitte Bardot (le film date de 1971), où elle semblait plus s’amuser qu’autre chose. On est loin du sérieux quelque peu pesant de La Vérité de Clouzot ou du Mépris de Godard.
Rassurez-vous, je ne suis pas en train de transformer la lettre Alternatif Bien-Être en rubrique nécrologique du septième art ; je veux évoquer avec vous la fin de ce film, qui sert de point de départ à cette lettre, la dernière de ma série sur les hormones de l’amour.
Plaisir d’amour… (air connu)
Boulevard du rhum est un film d’aventure plutôt léger, qui se déroule dans les années 1920 sur fond de contrebande d’alcool en pleine prohibition américaine : Lino Ventura y incarne un capitaine qui « lâche » brusquement le trafic parce qu’il devient fou amoureux d’une starlette, Linda Larue – Bardot, donc – qu’il découvre par hasard au cinéma.
Je vous passe les péripéties tragi-comiques qui s’ensuivent ; sachez simplement, si vous n’avez pas vu le film, que les personnages de Ventura et Bardot vivent une passion haute en couleurs, jusqu’à ce que diverses péripéties les séparent.
J’en viens à la fin du film.
Plusieurs années après leur dernière étreinte, Ventura se retrouve dans une salle de cinéma. On y donne le dernier film avec Linda Larue, qui évoque leur histoire.
Le film – le film dans le film, celui que regarde Ventura, et le film que nous, spectateurs, regardons – se termine par Bardot, interprétant une chanson bien connue : Plaisir d’amour :
« Plaisir d’amour ne dure qu’un moment
Chagrin d’amour dure toute la vie… »
Le choix de cette chanson n’a évidemment rien d’anodin.
Plaisir d’amour est un « tube » remontant… à la fin du XVIIIème siècle !
C’est une chanson plus vieille que la Révolution française et, partant, plus vieille que la Marseillaise !
Si elle est parvenue jusqu’à nous, abondamment reprise au XXème siècle – par Tino Rossi, Joan Baez, Marianne Faithfull, Nana Mouskouri et même Elvis Presley ! – c’est parce qu’elle s’est d’emblée imposée comme le prototype de la romance, évoquant le brutal et douloureux contraste entre les « hauts » de l’amour, et ses « bas » : la rupture, l’infidélité, les illusions perdues.
Son succès tient bien sûr en grande partie à l’universalité et à l’immortalité de la peine, de la douleur, de la souffrance ressenties lors d’une déception et/ou d’une séparation amoureuse.
Peine, douleur et souffrance qui s’expliquent notamment par… le brutal effondrement de toutes les hormones dont je vous ai parlées dans mes lettres précédentes.
Chagrin d’amour : les hormones sens dessus dessous !
« Dévasté »
« Anéantie »
« Il n’est plus que l’ombre de lui-même »
« Elle ne s’en est jamais relevée… »
Voilà des observations, des diagnostics, que vous avez forcément déjà entendu voire émis, ou dont vous avez peut-être même été le sujet.
Les séparations amoureuses, à tout âge de la vie, constituent souvent une blessure qui met beaucoup de temps à cicatriser.
Ce n’est qu’à peine une métaphore, comme vous allez le voir un peu plus loin.
Lorsqu’une relation amoureuse se termine, c’est tout un équilibre biologique qui se désorganise, parfois brutalement.
Pendant la phase amoureuse, l’organisme, nous l’avons vu ensemble, fonctionne sous un certain régime hormonal.
Dopamine, ocytocine, endorphines, vasopressine : ces molécules façonnent l’attachement, la motivation, le plaisir, le sentiment de sécurité.
Elles modifient l’activité de régions cérébrales bien précises, notamment celles impliquées dans la récompense, l’anticipation et la régulation émotionnelle.
La séparation agit comme une coupure nette de cet apport.
Une rupture est un sevrage
C’est comparable, en fait, au sevrage brutal d’une substance addictive.
Du jour au lendemain, votre cerveau et votre corps se retrouvent privés d’un stimulus auquel ils s’étaient profondément habitués.
La dopamine chute, et avec elle, votre élan vital, votre énergie, votre capacité à vous projeter. Ce n’est pas un hasard si tant de personnes séparées décrivent une fatigue écrasante, une perte d’envie, parfois une indifférence à ce qui auparavant les stimulait.
Ce tableau ressemble à s’y méprendre, sur le plan neurobiologique, à celui de la dépression.
L’ocytocine diminue elle aussi. Or c’est elle, vous vous en souvenez, qui, au fil des contacts, des regards, des gestes répétés, avait ancré le sentiment de proximité et de sécurité. Quand elle manque, le monde paraît soudain plus hostile, plus froid.
À cela s’ajoute une activation marquée des circuits du stress.
Le cortisol augmente ; le système nerveux autonome bascule vers un état d’alerte prolongée ; le sommeil se fragmente ; le rythme cardiaque devient plus instable.
L’appétit se dérègle. Certains mangent trop, d’autres plus du tout. Le corps se comporte comme s’il faisait face à une menace durable, sans savoir exactement laquelle.
C’est ici que la métaphore de la blessure cesse d’en être une.
Les conséquences physiologiques d’un chagrin d’amour
Sur le plan cérébral, les régions activées par la perte amoureuse recoupent largement celles impliquées dans la douleur physique. Le cerveau ne distingue pas clairement entre une atteinte du corps et une atteinte du lien.
Une étude[1] a par exemple montré que, chez des personnes récemment « quittées », la simple exposition à une photo de l’ex-partenaire stimule fortement les régions dopaminergiques liées au désir, à la motivation et à la récompense.
Autrement dit, le cerveau continue à « vouloir » l’autre, même en l’absence de relation.
Parallèlement, des zones associées à la douleur physique et au stress sont activées, ce qui explique pourquoi la séparation est vécue comme une véritable souffrance corporelle.
La rupture n’est donc pas seulement une peine psychologique : c’est un état de manque neurobiologique, proche d’un sevrage, qui rend la douleur intense et persistante, y compris d’un point de vue physique.
La souffrance provoquée par une rupture amoureuse n’est pas qu’une façon de parler.
Ces symptômes physiologiques liés au chagrin d’amour sont connus, et chantés par les poètes, depuis la nuit des temps. Les contes du Décaméron, au Moyen-Âge, racontent à plusieurs reprises comment des amants n’ayant pas la possibilité de vivre leur amour, meurent littéralement de chagrin.
Ce n’est pas une licence poétique !
C’est une réalité physiologique dont nous avons tous, pour peu que nous soyons dotés de sentiments humains, éprouvé au moins les symptômes les plus courants : la poitrine qui se serre, la gorge qui se noue, le ventre qui se contracte.
Plus spectaculaire, certaines ruptures intenses vous brisent le cœur.
Là encore, ça n’est pas qu’un cliché. Dans certains cas extrêmes, ce stress émotionnel intense peut même provoquer un dysfonctionnement transitoire du muscle cardiaque, comme si le cœur lui-même était débordé.
Le « syndrome du cœur brisé » est une pathologie médicale extrêmement bien documentée, également connue sous le nom de « syndrome de Takotsubo » – je vous en ai déjà parlé dans une précédente lettre[2] : c’est une atteinte aiguë et réversible du cœur, déclenchée le plus souvent par un stress émotionnel intense : rupture amoureuse, deuil, choc affectif.
Là encore, les hormones entrent en jeu : l’organisme libère une quantité massive de catécholamines (adrénaline, noradrénaline), toxiques pour le cœur.
Le ventricule gauche se déforme et perd une partie de sa capacité à se contracter, provoquant une douleur thoracique intense, un essoufflement, des signes très proches d’un infarctus.
Heureusement, ce syndrome est la plupart du temps réversible. On en guérit !
La séparation dans cette vie
Des « Takotsubo » sont diagnostiqués également lors de la perte d’un être cher.
Là encore, le cœur est l’organe qui, symboliquement, souffre le plus lors du décès d’un être aimé.
Une étude de 2012 atteste que la peine liée au décès d’un être cher est associée à un risque fortement augmenté d’infarctus dans les jours qui suivent, particulièrement chez les personnes déjà à risque cardiovasculaire[3].
Nous avons tous connu des couples dont le membre survivant est mort très peu de temps après le décès de son conjoint.
Oui, on peut mourir de chagrin, et c’est souvent l’effet le plus spectaculaire d’une séparation dans cette vie.
Quoi de plus « normal » en somme ? Il existe une fenêtre « aiguë » où le corps est particulièrement sous tension (stress, sommeil, inflammation, coagulation/pression artérielle chez certains), ce qui peut faire basculer un terrain fragile.
Cette fenêtre peut se mesurer en jours, en semaines, voire en mois ; elle correspond au deuil.
Les biomarqueurs d’un deuil intense
C’est quand un deuil se prolonge qu’il peut entraîner ce qui ressemble à s’y méprendre à un stress chronique.
Une étude publiée en 2022 a montré que, chez des personnes ayant perdu leur conjoint, celles qui rapportent des symptômes de deuil plus prononcés montrent une augmentation plus forte d’IL-6 (un marqueur inflammatoire) pendant un stress aigu[4].
À plus vaste échelle – c’est-à-dire non plus uniquement la perte d’un époux ou d’une épouse, mais celle d’un être cher, proche et aimé, quel qu’il soit – l’association entre l’intensité du deuil et les biomarqueurs de l’inflammation, et notamment des niveaux hauts de cortisol, est frappante[5].
Le deuil n’est pas seulement émotionnel : il s’accompagne, chez beaucoup de gens, d’une réponse inflammatoire et endocrinienne mesurable (et variable selon l’intensité du chagrin, le contexte, la santé de base…).
Outre sa dimension purement émotionnelle et humaine, une séparation douloureuse, ou pire encore un deuil, engendrent un état neurobiologique transitoire, coûteux, exigeant, qui demande du temps.
C’est une convalescence qui exige une « réorganisation » neuroendocrinologique profonde.
Et peut-être est-ce pour cela que, depuis plus de deux siècles, les paroles de Plaisir d’amour, et de bien d’autres chansons exprimant la douleur de la séparation, comme Ne me quitte pas, de Brel, continuent de résonner avec autant de justesse.
Non pas parce qu’elles exagèrent la souffrance, mais parce qu’elles la décrivent avec une acuité que la science, aujourd’hui, ne fait que confirmer et expliquer.
Si un chagrin d’amour ne dure pas nécessairement toute la vie, il dure en tout cas assez longtemps pour laisser une trace profonde dans le corps, le cerveau, et la mémoire.
C’est aussi cela, malgré tout, qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, je crois.
Vous pouvez me laisser votre sentiment à ce sujet en commentaire.
Portez-vous bien,
Rodolphe
P.-S. : Pour ceux d’entre vous que ça intéresse, Boulevard du rhum est visionnable en replay sur Arte jusqu’au 10 février (lien en source[6]).
[1] https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1102693108 – Ethan Kross, Marc G Berman, Walter Mischel, Tor D. Wager, « Social rejection shares somatosensory representations with physical pain », in PNAS, 28 mars 2011
[2] https://alternatif-bien-etre.com/sante-et-emotions/le-coeur-brise-ca-nest-pas-quune-facon-de-parler/ – Rodolphe Bacquet, « Le coeur brisé ça n’est pas qu’une façon de parler », site d’Alternatif Bien-Être, 13 septembre 2021
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22230481/ – Elizabeth Mostofsky, Malcolm Maclure et al, « Risk of acute myocardial infarction after the death of a significant person in one’s life : the Determinants of Myocardial Infarction Onset Study », in Circulation, 24 janvier 2012
[4] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9343888 – Ryan L Brown, Angie S LeRoy et al, « Grief Symptoms Promote Inflammation During Acute Stress Among Bereaved Spouses », in Psychological Science, 8 juin 2022
[5] https://midus.wisc.edu/findings/pdfs/1330.pdf – Miri Cohen, Stephen Granger & Esme Fuller-Thomson, « The Association Between Bereavement and Biomarkers of Inflammation », in Behavorial Medicine, 2015
[6] https://www.arte.tv/fr/videos/009364-000-A/boulevard-du-rhum/
Les lecteurs lisent aussi...
Mpox : alors, ça va recommencer ?
Alerte aux capteurs de glucose
Ça fait partie de moi
La taille des choses
Répondre à Richard. Annuler la réponse
En soumettant mon commentaire, je reconnais avoir connaissance du fait que Total Santé SA pourra l’utiliser à des fins commerciales et l’accepte expressément.

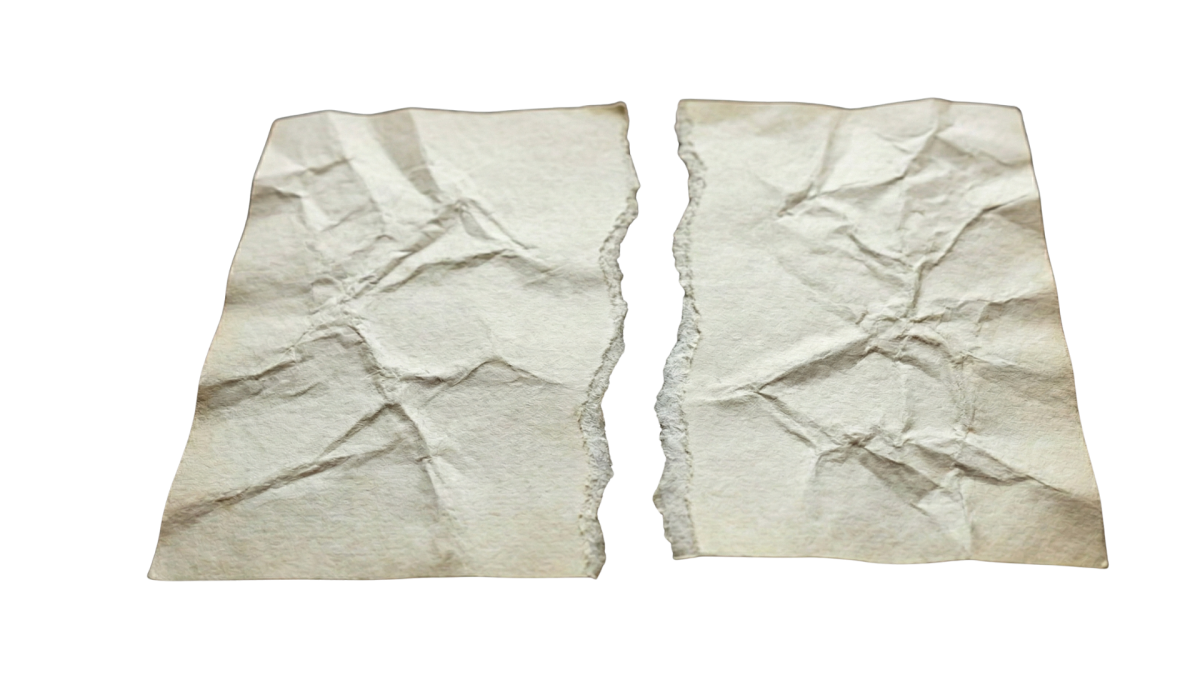

Bonjour Rodolphe,
Je suis abonnée et je vous lis depuis longtemps mais là franchement, votre article tombe à pic. Tout ce que vous décrivez est exactement pile poil le ressenti que j’ai depuis 8 jours avec tous les symptomes ! Je connais un homme depuis 22 ans et nous avons une relation amoureuse très proche depuis 5 ans. C’est un homme marié donc, la bêtise à ne pas faire, je l’ai faite… Bref, j’ai appris tout recemment que finalement ce n’était pas sûr qu’il puisse quitter sa femme malade d’un cancer alors que je ne supportais déjà plus son absence les week-ends. Donc là le monde s’est écroulé sous mes pieds. Grosse dépression… Je me bats pour lutter contre les symptomes de maux de tête, hausse de tension, coeur serré, extrasystols, grosse fatigue, problème de concentration, etc… Je n’ai trouvé que le sport pour me raccrocher car à 60 ans c’est plus difficile de se réinventer une nouvelle vie du jour au lendemain. Merci pour vos courriers très intéressants. Dans 1 an et demi je serai à la retraite, je changerai peut etre de région.
Je suis d’accords avec vous sur le chagrin d’amour mais on doit vivre quand même puis la vie malgré tout est belle 🩷
Bonjour, et merci Rodolphe pour votre article sur le DEUIL qui me permet de vous faire part de mon vécu récent et présent. Parfois, on cumule plusieurs chocs et ruptures dans une même vie !!!!
– Je me noyais dans le « chagrin » du décès, ce 23 Avril 2024 , de mon tendre et doux compagnon de ces 15 dernières années à 68 ans. Quel combat quotidien pour éviter de le rejoindre et quitter ce monde de fous, dans une perte totale de valeurs humaines … Ma détresse surpassait même mon attachement à mes deux filles et quatre petits enfants à 350 km … mon coeur était déchiqueté, en lambeaux … et je suis SEULE loin de toute famille …
– j’ai dépassé les 5 premiers mois cauchemardesques refusant l’allopathie qui m’aurait permis ma TDS. Rude combat contre mon mental et les questions qui n’ont pas de réponse …
J’ai cumulé: -des Fleurs de Bach, -du Griffonia/Rhodiola, – un hydrolat de Rose de Damas, -la bio résonance énergie quantique, -l’acupuncture, et la lecture de 5 livres sur le deuil et 19 mois plus tard un soutien psy depuis le mois dernier avec une psy spécialisée dans l’accompagnement du deuil …. J’ai eu le formidable soutien de mes filles et de mes amies par visio ou Mails, toutes éloignées en France car je suis à Bruxelles et belge . En retraite, je n’ai même plus la motivation de mon cabinet libéral qui donnait aussi du sens à ma vie.
– « Le chagrin ne s’exprime pas toujours avec des larmes, parfois il ronge le coeur… »
PS: à éviter lorsque l’on a été opérée à 54 ans d’une double malformation cardiaque de naissance !!!! Trouvée lors d’un examen demandé par la Banque pour un prêt que je n’ai pas eu !!!!
Ce qui sauve un peu mon deuil, c’est que pendant ces 15 années (dont 7 ensemble; nous habitions à 600 km l’un de l’autre pendant les 7 premières années car il fallait attendre sa retraite) j’ai TOUS les jours dit MERCI !!! D’avoir rencontré mon amour sur un catamaran aux 10 autres passagers, aux ÎLES GRENADINES, en janvier 2009 !!!! Mon chagrin est à la hauteur de l’intensité de notre merveilleuse, respectueuse et tendre relation et le vide est abyssal … J’ai dépassé un divorce au bout de 20 ans, une rupture , et un premier deuil d’un futur compagnon et … ce second deuil récent est la goutte d’eau qui fait déborder le vase … Ni mariés, ni pacsés mais ayant échangé nos alliances en présence de deux amis devant la Vierge d’un prieuré en 2011, il vivait chez moi « mon amour de SDF » … j’ai absolument rendu TOUTES SES AFFAIRES et sa voiture à ses deux jeunes non mariés de 36 et 39 ans. Malheureusement sa fille, jalouse et toxique a subtilisé son tel, sa Tablette et son carnet de MP le jour de son décès en palliatif. Je suis arrivée après et ne m’en suis pas rendue compte … Ensuite elle a changé mes mots de passe que possédait mon chéri, et bloqué mon mail principal, les hauts parleurs et la camera de surveillance … ainsi que celui de notre ordinateur … Je m’en sors enfin au bout de 20 mois, en ce qui concerne l’ordinateur !!! Tout cela pour dire que le deuil est déjà un sacré combat, mais ce qui se rajoute est intolérable . Heureusement, son frère est tout à fait correct et se trouve en porte à faux obligé de faire avec … lui aussi. Voilà mon témoignage et mon vécu dans l’espoir de retrouver un peu de douceur, et de paix, et un jour me rapprocher de mes filles et revenir en France … et qui sait peut être un nouvel amour, différent mais réel ??? Bien à vous
Bonsoir ,je ne vais pas parler de rupture mais de deuil,
Mon chéri époux est décédé en avril dernier et le chagrin est immense. Et quelques mois après j’ai eu un grosse fatigue et une inflammation du foie avec tous les marqueurs explosés . Mon médecin m’a même demandé sur le ton de l’humour si je n’avais pas noyé mon chagrin dans l’alcool 😡.
Alors que je ne bois presque jamais mon estomac ne le supportant pas. Ceci pour dire que une grande peine peut avoir des contre coups inattendus sur le corps. Un drainage du foie a remis les choses dans l’ordre très rapidement.
Mais comme je crois a la vie après la mort . J’ai participé à une Amih à Toulouse avec le docteur Charbonier sans contact pour l’instant mais je garde espoir et je ferai une PCH à Lyon en novembre. prochain
Oh je vous comprends … un peu … je dois dire que je n’ai pas envie de faire une AMIH (ex TCH) avec JJ Charbonier car revoir mon amour et le REquitter me semble encore impossible à envisager … en revanche j’ai fait 2 PCH avec JJ C une 6 mois avant le décès de mon chéri à 68 ans (son cancer du Pancréas s’est déclaré deux mois plus tard) et une 6 mois plus tard … Depuis, je ne souffre pratiquement plus au quotidien … suite à mon accident à l’âge de 15 ans … j’en ai 73 …. je ne garde aucun souvenir de la 1ère contrairement à bcp de témoignages, en revanche, j’ai suivi son protocole et son scan du corps à la seconde . Mon regret c’est que lors de mes 15 années de couple, mon chéri ne m’a pas connue « normale » sans douleur à la marche et station debout et, Je n’ai plus sa main dans la mienne lorsque je marche …
Grand merci Rodolphe pour cet article éclairé et éclairant sur plusieurs dimensions des éléments qui font partie de la rupture. Un deuil est nécessaire, et on doit prendre le temps de le faire, afin de ne pas replonger mal préparé pour amorcer une nouvelle relation amoureuse. Par contre, je dirais qu’avec le passage des année, je suis de plus en plus porté à garder les bons souvenirs et mettre en veilleuse les passages difficiles, qui n’ont plus beaucoup d’importance aujourd’hui. L’amour intime demeure, mais l’Amour universel devient davantage présent dans ma vie, et c’est pour le mieux. Merci encore!
oui, et alors, qu’est ce qu’on fait? on se dope aux hormones?
ou bien on fait le travail de deuil, qui amène à une autre appréhension du monde?
on arrête de se prendre pour un robot hormonal pour advenir à un humain ayant une vie psychique en devenir
Et si l’esprit était plus fort que la matière? lisez « les mots pour le dire », de Marie Cardinal, la première personne qui a témoigné de son parcours psychanalytique, et d’un changement physiologique radical après une interprétation de son psychanalyste.
je continue à vous lire, mais je me lasse de ce côté réducteur. le cerveau, comme les hormones, ne sont que des courroies de transmission, des récepteurs .. d’autre chose
merci et à bientôt
Bonjour Rodolphe,
Tout à fait vrai. Merci pour cet enrichissant documentaire.
Fin des hormones de l’amour, c’est bien ! Heureusement que l’humour sauve de l’ennui. Merci
Merci Rodolphe pour vos chroniques intéressantes, bien écrites et pleines d’humour!
Bonne année à vous, pleine d’inspiration!!
Grand merci pour cet article tellement interessant. On passe tous par des moments compliques et vraiment il faut une bonne dose de cervelle et de creativite comme des routines pour ne pas sombrer. Malgré tout on reprend courage et peut être est ce ceci la clé et de se dire demain sera bien meilleur!
Bonne et heureuse année!
Merci pour cet article très intéressant. Une question cependant qui est rarement abordée. Que se passe-t-il chez une personne amoureuse qui décide de rompre sa relation avec l’etre aimé car cette relation est déséquilibrée et toxique ?
Une analyse intéressante dans la lecture , pragmatique et drôle 👍